Retraite, partie deux : le sénateur Sinclair dit adieu au Sénat
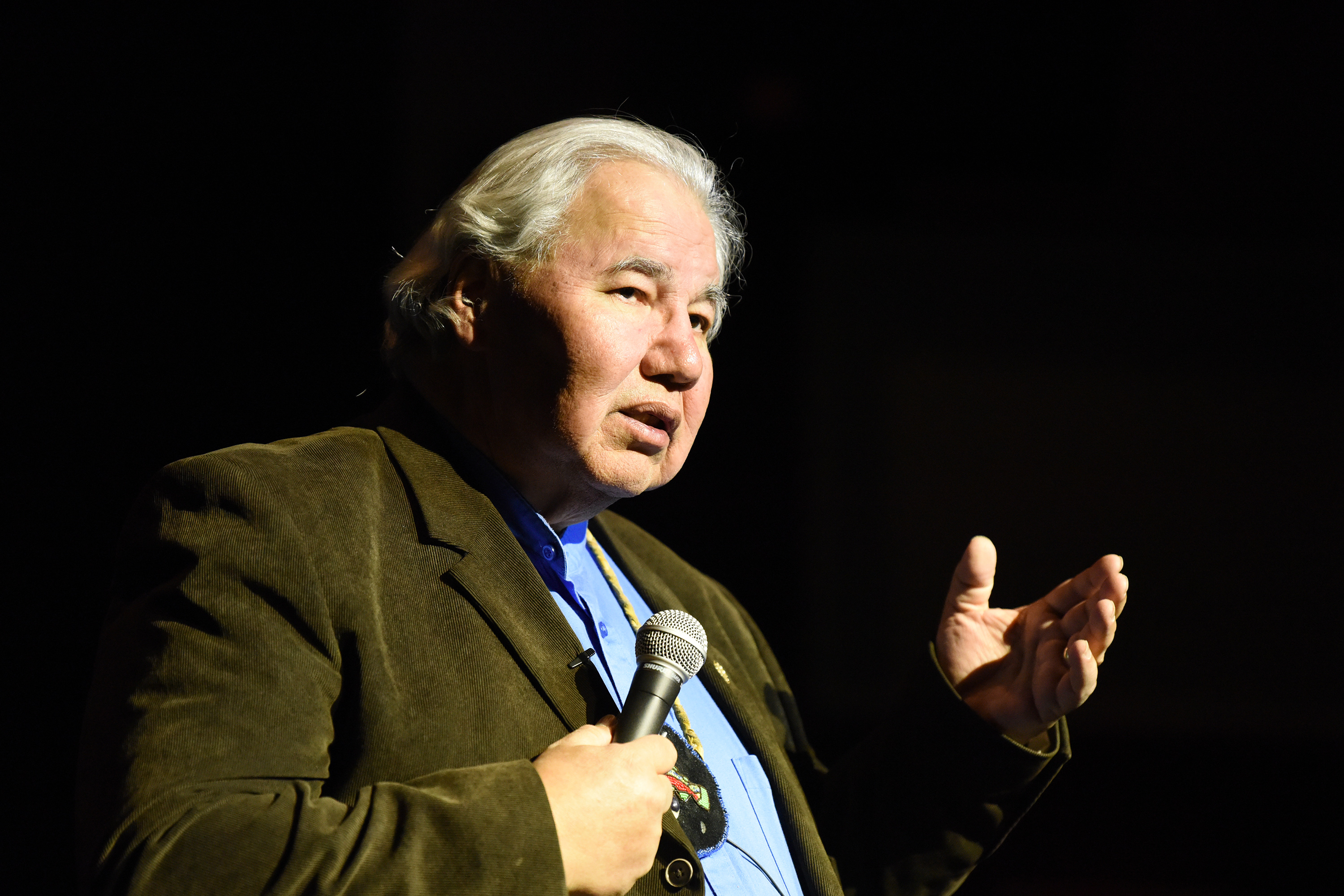
Le sénateur Murray Sinclair a été le premier juge autochtone du Manitoba et le deuxième du Canada, mais on le connaît davantage comme président de la Commission de vérité et réconciliation. À ce titre, il a pris part à des centaines d’audiences tenues aux quatre coins du pays pour entendre les témoignages de survivants du régime de pensionnats indiens et de ses effets persistants sur les peuples autochtones.
C’est en 2016 qu’il a été nommé au Sénat, où il a continué à plaider en faveur de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones du Canada. Pendant les cinq années qu’il a passées à la Chambre rouge, il a siégé à plusieurs comités, dont le Comité sénatorial des peuples autochtones et le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles.
SenCAplus a demandé au sénateur Sinclair de réfléchir à sa carrière au Sénat avant son départ le 31 janvier 2021.

Vous avez été nommé au Sénat en 2016. Comment avez-vous réagi à l’appel téléphonique du premier ministre?
Je rappelle aux gens que lorsque la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a pris fin le 15 décembre 2015, dans mes observations finales, j’avais fait part de mon intention de me retirer de la vie publique et j’avais mentionné que le temps était venu pour moi de me consacrer davantage à ma famille, en particulier à ma femme. Elle avait consacré une grande partie de son temps à ma carrière, et sans son soutien, je n’aurais pas pu accomplir les choses qui m’étaient demandées.
Nous avons donc clos la CVR et j’ai donné ma démission, laquelle a pris effet le 31 janvier 2016, mon dernier jour en qualité de juge. Les premiers jours, j’ai beaucoup marché, promené mes chiens et contemplé toutes choses. En fait, j’étais au beau milieu d’une promenade lorsque j’ai reçu un appel du premier ministre Justin Trudeau. Il m’a promptement demandé si j’étais disposé à accepter une nomination au Sénat. J’ai dit : « Eh bien, Monsieur le Premier Ministre, vous étiez à la cérémonie de clôture et m’avez entendu dire que je me retirais de la vie publique. » Il a rétorqué qu’il ne me proposerait pas le poste s’il ne pensait pas que c’était important; il m’a exposé ses vues et les raisons pour lesquelles il me voulait au Sénat.
J’en ai donc discuté avec ma famille, et ma femme a dit : « Bon, te voilà à la retraite depuis huit jours et tu as réorganisé mes armoires trois fois. De toute façon, j’allais te demander de te trouver un emploi à temps partiel. » Elle a ajouté qu’elle pourrait probablement s’y faire à condition que ce ne soit pas pour le reste de ma vie. Je lui ai assuré que je le ferais pour cinq ans et que je réévaluerais la situation par la suite.
Est-ce pour cela que vous quittez votre poste si tôt? Vous auriez pu continuer jusqu’en 2026!
C’était la principale considération. J’ai pris un engagement de cinq ans et je ne voulais pas passer le reste de ma vie au Sénat. À mon sens, la pandémie représentait le moment opportun car je ne suis pas allé très souvent à Ottawa au cours de la dernière année en raison du travail virtuel. Mais par-dessus tout, ma femme n’est pas en bonne santé, elle a de plus grands besoins et elle est vulnérable sur le plan médical. J’ai cru avoir accompli certaines choses utiles, et j’ai jugé qu’il était temps de passer à autre chose et de laisser les autres sénateurs autochtones au Sénat prendre le flambeau.

Niigaan, votre fils, a écrit une lettre d’opinion (en anglais seulement) relatant sur un ton affectueux votre dévouement envers votre communauté comme premier juge autochtone au Manitoba et comme président de la Commission de vérité et réconciliation. Comment ces expériences ont-elles marqué votre travail au Sénat?
L’expérience que j’ai acquise en présidant la CVR, en recevant les témoignages de survivants et en travaillant auprès de personnes qui cherchaient à se faire entendre afin que d’autres puissent en bénéficier m’a fait comprendre l’importance du leadership. Mon rôle comme juge a fortement influencé ma façon d’aborder les choses. J’ai pris conscience de la nécessité d’écouter ce que les gens ont à dire avant de passer à l’action, de façon à réduire les tensions au cours du dialogue.
Le plus bel exemple, c’est le travail que j’ai fait pour le projet de loi de Romeo Saganash qui concernait la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cela a été la pierre angulaire des appels à l’action lancés par la CVR pour amener les institutions canadiennes, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux, à vouloir utiliser la Déclaration des Nations Unies comme cadre de réconciliation.
Pouvoir expliquer ça aux sénateurs, à la population et aux personnes qui ont présenté des exposés sur le sujet, même à celles qui s’opposaient à la déclaration, a été une occasion en or de sensibiliser les gens, et je pense avoir été en mesure de le faire. Le gouvernement a maintenant déposé un projet de loi qui vise le même objectif. Je crois qu’il recevra un meilleur appui de la part du Sénat que le projet de loi initial parce que nous avons fait le travail nécessaire pour amener les gens à en comprendre le bien‑fondé et celui de la déclaration. Maintenant, les bases ont été jetées et je pense que le projet de loi franchira plus facilement les étapes au Sénat.

Dans votre premier discours à la Chambre haute, vous avez fait mention du Sénat comme étant le « conseil des aînés » du Canada et vous avez indiqué que vous aviez accepté d’y être nommé dans l’espoir de poursuivre le travail de réconciliation grâce à l’éducation et à la compréhension. De quelle façon aimeriez-vous que cette vision se poursuive?
Le Sénat devrait réellement se considérer comme un conseil des aînés pour le pays; cela veut dire qu’au sein d’un tel conseil, il n’y a pas de place pour la partisanerie. Chacun doit s’exprimer de façon indépendante sur l’avenir du pays et avoir à cœur l’intérêt supérieur du pays. Cela implique une vision de la réconciliation qui ne relève pas de la protection des intérêts. C’est une vision du Sénat qui est différente de la vision actuelle.
Vous quittez le Sénat en y laissant un héritage de défense de la nature. Vous avez contribué au parrainage du projet de loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins qui est devenu loi en juin 2019, et maintenant vous vous efforcez d’offrir la même protection aux grands singes et aux éléphants. Pourquoi est-ce important pour vous que le Parlement adopte le projet de loi S-218, la Loi de Jane Goodall?
Cela montre comment, au pays, on doit considérer notre relation avec les autres êtres de la création. Nous devons considérer les autres créatures qui vivent avec nous non pas uniquement comme des biens; nous devons nous montrer plus respectueux envers elles parce que ce sont des êtres vivants. Ils ont été placés ici dans un but et nous devons comprendre et respecter ce but. Notre intention était d’amener les gens à considérer autrement les animaux, et à voir que les trophées de chasse ou l’installation d’animaux sur des présentoirs à des fins de divertissement sont à proscrire. Nous n’en faisons pas assez à cet égard. Le but de la Loi de Jane Goodall est d’établir certains paramètres, qui reconnaissent non seulement ce principe des plus élémentaires, mais également le rôle de Jane Goodall (en anglais seulement).
Quels conseils donneriez-vous au prochain autochtone nommé au Sénat?
Il faut se rappeler que nombreux sont ceux qui vous précèdent. Au moment de la présente entrevue, 12 sénateurs autochtones sont en poste. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de la perspective autochtone et de situations qui se présentent aussi bien au Sénat que sur la scène publique. Nous demandons aux membres du Cabinet de venir s’entretenir avec nous. Nous rencontrons les membres autochtones de la Chambre des communes pour déterminer quelle approche collective adopter dans l’intérêt de la communauté autochtone. Les sénateurs qui nous succéderont doivent savoir que des gens ont déjà pavé la voie, que d’autres sénateurs autochtones préconisent déjà les changements qui s’imposent pour parvenir à la réconciliation et que leurs préoccupations recevront non seulement un appui, mais continueront d’être entendues au Sénat.

Articles connexes
Étiquettes
Nouvelles des comités
Retraite, partie deux : le sénateur Sinclair dit adieu au Sénat
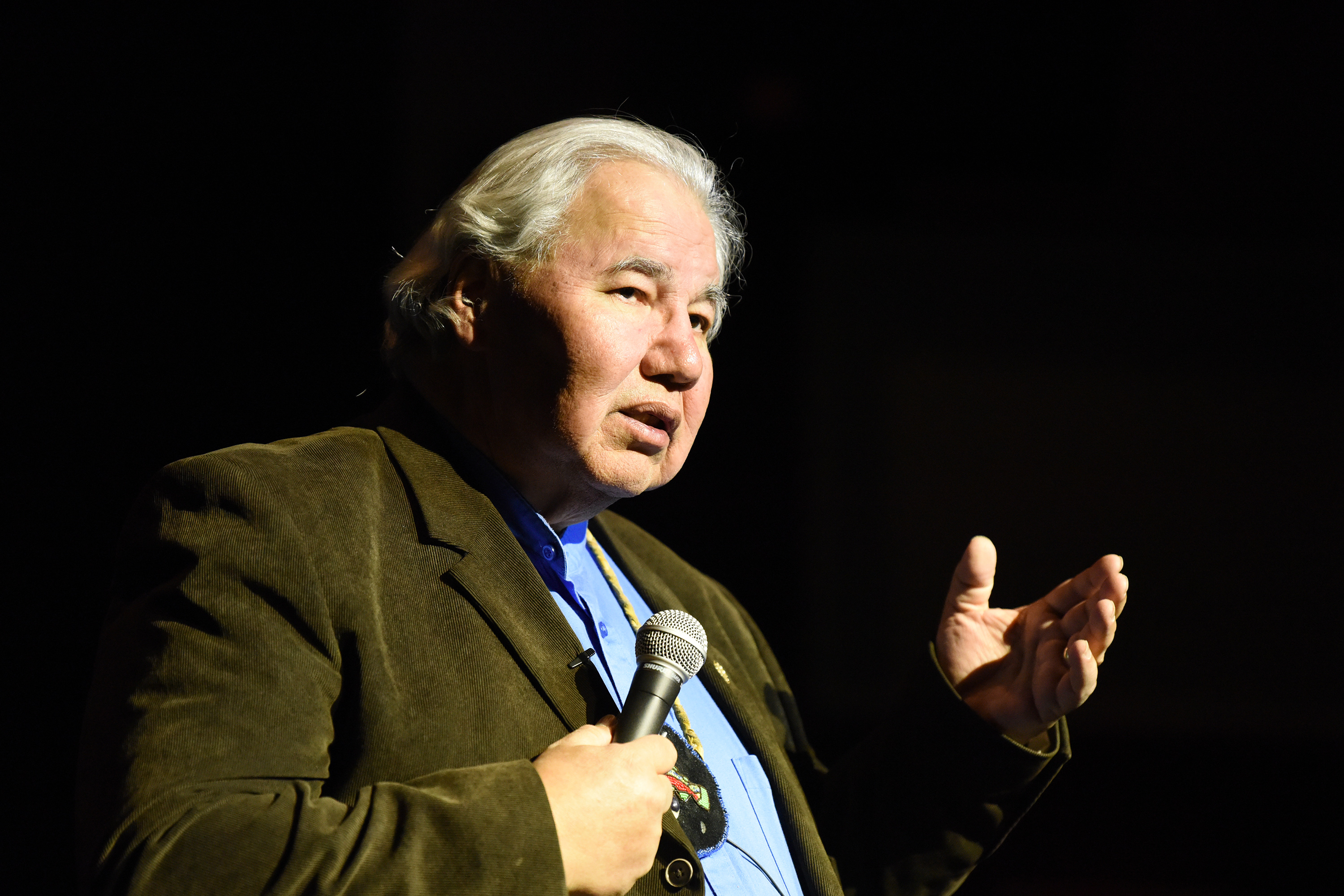
Le sénateur Murray Sinclair a été le premier juge autochtone du Manitoba et le deuxième du Canada, mais on le connaît davantage comme président de la Commission de vérité et réconciliation. À ce titre, il a pris part à des centaines d’audiences tenues aux quatre coins du pays pour entendre les témoignages de survivants du régime de pensionnats indiens et de ses effets persistants sur les peuples autochtones.
C’est en 2016 qu’il a été nommé au Sénat, où il a continué à plaider en faveur de la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones du Canada. Pendant les cinq années qu’il a passées à la Chambre rouge, il a siégé à plusieurs comités, dont le Comité sénatorial des peuples autochtones et le Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles.
SenCAplus a demandé au sénateur Sinclair de réfléchir à sa carrière au Sénat avant son départ le 31 janvier 2021.

Vous avez été nommé au Sénat en 2016. Comment avez-vous réagi à l’appel téléphonique du premier ministre?
Je rappelle aux gens que lorsque la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a pris fin le 15 décembre 2015, dans mes observations finales, j’avais fait part de mon intention de me retirer de la vie publique et j’avais mentionné que le temps était venu pour moi de me consacrer davantage à ma famille, en particulier à ma femme. Elle avait consacré une grande partie de son temps à ma carrière, et sans son soutien, je n’aurais pas pu accomplir les choses qui m’étaient demandées.
Nous avons donc clos la CVR et j’ai donné ma démission, laquelle a pris effet le 31 janvier 2016, mon dernier jour en qualité de juge. Les premiers jours, j’ai beaucoup marché, promené mes chiens et contemplé toutes choses. En fait, j’étais au beau milieu d’une promenade lorsque j’ai reçu un appel du premier ministre Justin Trudeau. Il m’a promptement demandé si j’étais disposé à accepter une nomination au Sénat. J’ai dit : « Eh bien, Monsieur le Premier Ministre, vous étiez à la cérémonie de clôture et m’avez entendu dire que je me retirais de la vie publique. » Il a rétorqué qu’il ne me proposerait pas le poste s’il ne pensait pas que c’était important; il m’a exposé ses vues et les raisons pour lesquelles il me voulait au Sénat.
J’en ai donc discuté avec ma famille, et ma femme a dit : « Bon, te voilà à la retraite depuis huit jours et tu as réorganisé mes armoires trois fois. De toute façon, j’allais te demander de te trouver un emploi à temps partiel. » Elle a ajouté qu’elle pourrait probablement s’y faire à condition que ce ne soit pas pour le reste de ma vie. Je lui ai assuré que je le ferais pour cinq ans et que je réévaluerais la situation par la suite.
Est-ce pour cela que vous quittez votre poste si tôt? Vous auriez pu continuer jusqu’en 2026!
C’était la principale considération. J’ai pris un engagement de cinq ans et je ne voulais pas passer le reste de ma vie au Sénat. À mon sens, la pandémie représentait le moment opportun car je ne suis pas allé très souvent à Ottawa au cours de la dernière année en raison du travail virtuel. Mais par-dessus tout, ma femme n’est pas en bonne santé, elle a de plus grands besoins et elle est vulnérable sur le plan médical. J’ai cru avoir accompli certaines choses utiles, et j’ai jugé qu’il était temps de passer à autre chose et de laisser les autres sénateurs autochtones au Sénat prendre le flambeau.

Niigaan, votre fils, a écrit une lettre d’opinion (en anglais seulement) relatant sur un ton affectueux votre dévouement envers votre communauté comme premier juge autochtone au Manitoba et comme président de la Commission de vérité et réconciliation. Comment ces expériences ont-elles marqué votre travail au Sénat?
L’expérience que j’ai acquise en présidant la CVR, en recevant les témoignages de survivants et en travaillant auprès de personnes qui cherchaient à se faire entendre afin que d’autres puissent en bénéficier m’a fait comprendre l’importance du leadership. Mon rôle comme juge a fortement influencé ma façon d’aborder les choses. J’ai pris conscience de la nécessité d’écouter ce que les gens ont à dire avant de passer à l’action, de façon à réduire les tensions au cours du dialogue.
Le plus bel exemple, c’est le travail que j’ai fait pour le projet de loi de Romeo Saganash qui concernait la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cela a été la pierre angulaire des appels à l’action lancés par la CVR pour amener les institutions canadiennes, y compris les gouvernements fédéral et provinciaux, à vouloir utiliser la Déclaration des Nations Unies comme cadre de réconciliation.
Pouvoir expliquer ça aux sénateurs, à la population et aux personnes qui ont présenté des exposés sur le sujet, même à celles qui s’opposaient à la déclaration, a été une occasion en or de sensibiliser les gens, et je pense avoir été en mesure de le faire. Le gouvernement a maintenant déposé un projet de loi qui vise le même objectif. Je crois qu’il recevra un meilleur appui de la part du Sénat que le projet de loi initial parce que nous avons fait le travail nécessaire pour amener les gens à en comprendre le bien‑fondé et celui de la déclaration. Maintenant, les bases ont été jetées et je pense que le projet de loi franchira plus facilement les étapes au Sénat.

Dans votre premier discours à la Chambre haute, vous avez fait mention du Sénat comme étant le « conseil des aînés » du Canada et vous avez indiqué que vous aviez accepté d’y être nommé dans l’espoir de poursuivre le travail de réconciliation grâce à l’éducation et à la compréhension. De quelle façon aimeriez-vous que cette vision se poursuive?
Le Sénat devrait réellement se considérer comme un conseil des aînés pour le pays; cela veut dire qu’au sein d’un tel conseil, il n’y a pas de place pour la partisanerie. Chacun doit s’exprimer de façon indépendante sur l’avenir du pays et avoir à cœur l’intérêt supérieur du pays. Cela implique une vision de la réconciliation qui ne relève pas de la protection des intérêts. C’est une vision du Sénat qui est différente de la vision actuelle.
Vous quittez le Sénat en y laissant un héritage de défense de la nature. Vous avez contribué au parrainage du projet de loi visant à mettre fin à la captivité des baleines et des dauphins qui est devenu loi en juin 2019, et maintenant vous vous efforcez d’offrir la même protection aux grands singes et aux éléphants. Pourquoi est-ce important pour vous que le Parlement adopte le projet de loi S-218, la Loi de Jane Goodall?
Cela montre comment, au pays, on doit considérer notre relation avec les autres êtres de la création. Nous devons considérer les autres créatures qui vivent avec nous non pas uniquement comme des biens; nous devons nous montrer plus respectueux envers elles parce que ce sont des êtres vivants. Ils ont été placés ici dans un but et nous devons comprendre et respecter ce but. Notre intention était d’amener les gens à considérer autrement les animaux, et à voir que les trophées de chasse ou l’installation d’animaux sur des présentoirs à des fins de divertissement sont à proscrire. Nous n’en faisons pas assez à cet égard. Le but de la Loi de Jane Goodall est d’établir certains paramètres, qui reconnaissent non seulement ce principe des plus élémentaires, mais également le rôle de Jane Goodall (en anglais seulement).
Quels conseils donneriez-vous au prochain autochtone nommé au Sénat?
Il faut se rappeler que nombreux sont ceux qui vous précèdent. Au moment de la présente entrevue, 12 sénateurs autochtones sont en poste. Ils se réunissent régulièrement pour discuter de la perspective autochtone et de situations qui se présentent aussi bien au Sénat que sur la scène publique. Nous demandons aux membres du Cabinet de venir s’entretenir avec nous. Nous rencontrons les membres autochtones de la Chambre des communes pour déterminer quelle approche collective adopter dans l’intérêt de la communauté autochtone. Les sénateurs qui nous succéderont doivent savoir que des gens ont déjà pavé la voie, que d’autres sénateurs autochtones préconisent déjà les changements qui s’imposent pour parvenir à la réconciliation et que leurs préoccupations recevront non seulement un appui, mais continueront d’être entendues au Sénat.



